Le pitch : 1972, Richard Collier, un auteur dramatique se voit aborder par une vieille femme qui lui donne une montre en lui disant "Reviens moi, je t'en supplie". En cherchant à en savoir plus, il va découvrir qu'il a connu cette femme, Elyse McKenna, une actrice... en 1912.
Quelque part dans le temps est sans doute l'une des plus belles histoires d'amour du cinéma. Mais c'est aussi le film fantastique sans effet visuel le plus étonnant que l'on puisse voir. Porté par un casting étincelant (Christopher Reeves, Jane Seymour et Christopher Plummer), mis en scène avec une élégance rare par le très bon Jeannot Szwarc qui s'empare avec brio de la nouvelle de Richard Matheson et déroulant une histoire absolument merveilleuse, le film , sorti en 1980 est bien plus qu'un classique. C'est aussi et surtout la preuve que le cinéma peut faire voyager, rêver et pleurer sans se servir des artifices classiques.
Si on y ajoute une sublime musique de John Barry, une reconstitution minutieuse de l'avant guerre aux USA et qu'on accepte le postulat que le héros remonte le temps par la seule force de sa pensée, on est vraiment face à un chef d'oeuvre.
Car tout dans ce film est sublime. Des première scènes dans un New York finalement très artificiel à la scène finale (qui a forcément inspiré James Cameron, j'y reviendrai) , en passant par la longue quête de Collier pour comprendre pourquoi cette femme lui a donné ce médaillon, l'histoire prend son temps et ne force jamais la main au spectateur. Bien au contraire, elle le laisse imaginer , faire la part des choses, comprendre que tel indice laissé dans la partie contemporaine (le groom qui se rappelle qu'en 1912, son père lui interdisait de jouer au ballon dans l'hôtel) va forcément se retrouver dans la partie située dans le passé. Le script égrène son histoire petit à petit.
Alors , bien sûr, les esprits cyniques se gausseront de cette folle histoire d'amour , de sa naïveté voire de sa chasteté. Ils critiqueront l'absence d'effets visuels lors du voyage dans le temps (le héros s'endort dans sa chambre d'hôtel et à son réveil, il est en 1912, sans explication aucune). Ils pourront même taper sur le rythme lent. Mais qu'importe.
Porté par deux acteurs totalement en symbiose , Reeves qui fait oublier ici la toute puissance de son Superman et Jane Seymour, d'une beauté renversante, la rencontre, finalement tardive, propulse ce qui n'aurait pu être qu'une banal histoire de paradoxe temporel, dans une autre dimension, celle où la caméra se fait confidente d'une histoire naissante.
Une scène magistrale parmi d'autres : alors que Elise McKenna joue la pièce dont elle est la vedette devant un public fasciné, elle brise alors le 4e mur et s'adresse directement à Collier, lui avouant son amour, avant de reprendre le fil de sa pièce. D'après le réalisateur, dans l'excellent entretien qu'il donne en bonus à Marc Toullec (Mad Movies, Impact) , cette scène fut l'une des plus dures à tourner, en raison de l'intensité de son dialogue. Mais au final, quelle merveille !!
Réalisé avec peu de moyens (des figurants bénévoles, un hôtel qui mit son bâtiment à la disposition de la production, un tournage de seulement 5 semaines) et un studio qui ne s'intéressait pas du tout au film - Szwarc sortait des Dents de la mer 2 et les pontes d'Universal aurait préféré qu'il fasse un autre blockbusters - , c'est le film le plus personnel de son auteur , et même s'il fut un échec à sa sortie, il gagna ses galons d'oeuvre culte au fur et à mesure du temps.
42 ans après sa sortie, il faut redécouvrir ce merveilleux conte. J'avais eu la chance de le voir en 1980 même si, il faut l'avouer, j'espérais surtout voir Superman remonter le temps. Mais déjà à cette époque, j'avais été subjugué par l'économie de moyens et par la puissance de l'histoire. Le Blu-ray se trouve facilement et à petit prix.
Maintenant, parlons de Cameron. Un personnage qui remonte le temps par amour, deux amants qui se retrouvent à la toute fin du métrage dans leur prime jeunesse par delà la mort... Je reste persuadé que le grand James a vu Quelque part dans le temps, qu'il l'a aimé et que, quelque part, les images les plus fortes lui sont restées en tête.
A vous de juger.

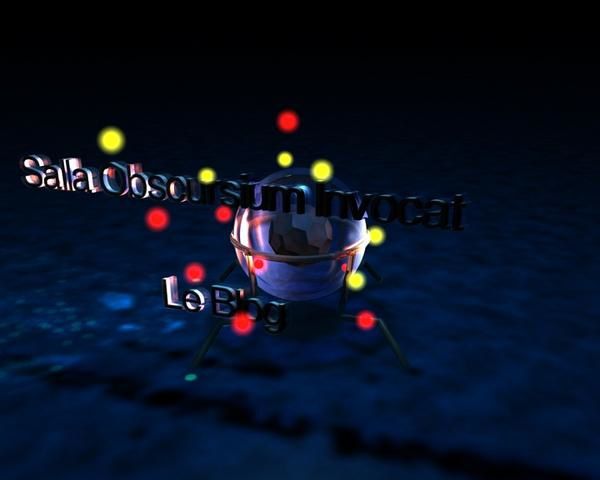
/image%2F0556296%2F20220125%2Fob_1043d5_51rjxh0v5al-ac-sy445.jpg)


/image%2F0556296%2F20211005%2Fob_489d21_panic-sur-florida-beach-de-joe-dante-v.jpg)
/image%2F0556296%2F20210223%2Fob_a64d77_p39264.jpg)
/image%2F0556296%2F20201206%2Fob_268e98_p14797.jpg)





/image%2F0578386%2F201305%2FphpKX6pcz)
/image%2F0556296%2F20211123%2Fob_f18aac_feaiqkpwqa0b80.jpeg)
 sallaobscursiuminvocat
sallaobscursiuminvocat